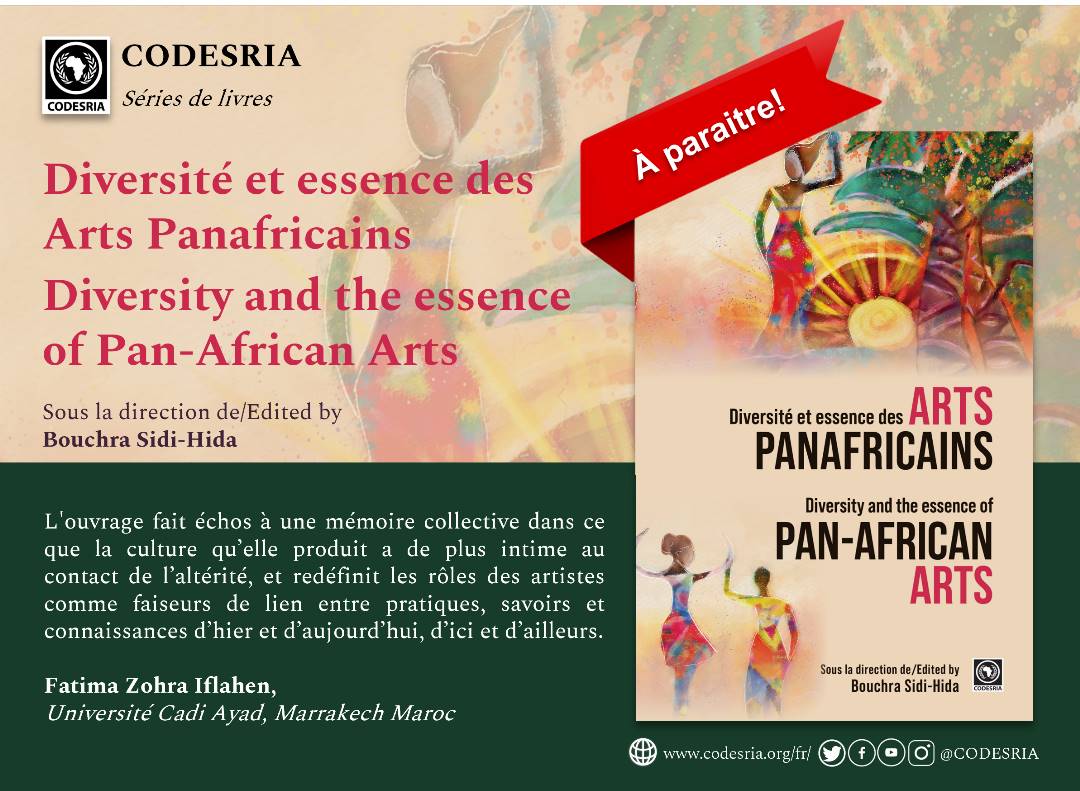Atelier d’une journée et demie organisé par le CODESRIA / NAI
8-9 décembre 2022, Dakar, Sénégal
Cet atelier hybride est une invite à une réflexion collective sur le rôle de la mobilité humaine dans le façonnement de l’avenir économique, politique et social de l’Afrique de l’Ouest, avec un accent particulier sur les pratiques, les aspirations et les réflexions des jeunes de la région. L’atelier a pour objectif de faciliter un échange entre chercheurs, décideurs, analystes politiques et jeunes militants sur ce thème important.
Les jeunes sont souvent le fer de lance de la mobilisation politique et du changement sociétal. Dans de nombreux contextes ouest-africains, la mobilité humaine est devenue de plus en plus centrale pour ces forces. Dans la région du Sahel en particulier, la violence djihadiste a généré la crise et des mouvements migratoires en croissance rapide. Dans le même temps, au lendemain de la soi-disant crise des réfugiés de 2015-2016, les interventions européennes remettent en cause les principes anciens de libre circulation dans la région. Comment ces défis affectent-ils les perspectives et les rôles des jeunes dans la sous-région ? On peut prendre 2010 comme la décennie charnière où les jeunes, du Caire au Cap, ont fait entendre leur voix dans les rues ; pourtant, de nombreux observateurs extérieurs au continent craignent désormais que leur avenir ne soit celui d’une émigration accrue vers le Nord. Ces craintes découlent d’une projection de croissance démographique du continent et de la menace de conflits et de déplacements liés au climat. Assistons-nous à un passage d’une génération de voix à une génération d’exode ?
Sous un éclairage plus historique, plus social et plus politique, l’idée que la jeune génération ouest-africaine cherche fortune ailleurs semble davantage refléter des préoccupations politiques extérieures que des réalités empiriques. La mobilité humaine a joué un rôle incomparable dans l’histoire politique, économique et sociale de l’Afrique de l’Ouest. En plus de sa longue histoire de peuplement et d’échanges, l’économie politique de la région a, dans une large mesure, été façonnée autour de la disponibilité d’une main-d’œuvre mobile. Sous l’occupation coloniale, cette ressource humaine a été systématiquement exploitée par le biais du travail forcé et des économies de plantations et extractives et, après l’indépendance, elle a été transformée en systèmes régionaux de migration circulaire qui ont, de manière significative, configuré le paysage géopolitique et économique de la région. Dans le même temps, l’épuisement progressif des terres arables a créé des tensions grandissantes dans les régions les plus fertiles, et ces tensions et conflits localisés ont, à leur tour, alimenté des discours politiques qui ont ciblé et diabolisé les migrants. Enfin, parallèlement à ces grandes mutations historiques, dans cette région, les liens sociaux et familiaux ont toujours rapproché des personnes séparées par de longues distances, et, comme elle le fait depuis des générations, la mobilité continue ainsi de fonctionner comme une ressource sociale fondamentale.
À la lumière de cette histoire économique, politique et sociale récente, le rôle de la mobilité en Afrique de l’Ouest est actuellement altéré par les régimes restrictifs de gouvernance des migrations imposés par les européens, la menace croissante du djihadisme dans la région du Sahel, et la réponse aux défis mondiaux liés à la pandémie de covid-19 et à la guerre en Ukraine. Dans cet assaut de mesures et de discours limitant la mobilité, les jeunes sont de plus en plus définis comme le cœur du problème tel que perçu. La région ouest africaine a la population la plus jeune du monde et, selon les projections de croissance démographique, au cours de la prochaine génération, le nombre de personnes à la recherche d’une meilleure vie et de moyens de subsistance significatifs devrait doubler. Ce qui s’entend le moins, par contre, ce sont les voix de jeunes d’Afrique de l’Ouest eux-mêmes.
Les contributions devront aborder le thème général de l’atelier, comme indiqué ci-dessus, et être traiter de l’un des sous-thèmes suivants :
- Comprendre le travail des jeunes mobiles
Dans de nombreux contextes ouest-africains, la mobilité est liée aux stratégies de subsistance. Les jeunes aspirent à de meilleures conditions de vie et sont censés, par le travail, contribuer à leur propre subsistance et, parfois, à celle de leur famille, et la mobilité interne ou transnationale peut servir de ressource centrale. La mobilité régionale est souvent évoquée en termes de source de main-d’œuvre mobile, mais rarement appréhendée empiriquement, et les rôles et expériences des jeunes sont particulièrement absents. Comment la main-d’œuvre mobile jeune est-elle recrutée et organisée ? Qui sont les intermédiaires de ces mouvements, et comment les formes, les effets et les discours ont-ils été modifiés ou consolidés au cours de la dernière décennie ?
- Mobilisation sociale et politique des jeunes
Dans l’hémisphère Nord, la politisation accrue de l’immigration domine la pensée actuelle autour des mobilités africaines en général, et des mobilités des jeunes ouest-africains en particulier. Dans le même temps, les jeunes de nombreux contextes ouest-africains remettent en question ces perceptions externes de leurs aspirations et de leurs pratiques, et se mobilisent pour revendiquer que soient reconnus leurs droits fondamentaux, et de leurs dirigeants élus, la responsabilité et l’action. A cet égard, les politiques de mobilité sont autant liées aux structures de pouvoir et aux injustices mondiales qu’elles reflètent des questions plus localisées d’identité, de citoyenneté et d’appartenance. Comment les jeunes se mobilisent-ils par rapport aux discours ou itinéraires liés à la mobilité ? Quels sont leurs griefs et qui sont leurs publics ?
- Déconstruire la migration des enfants et des jeunes
Dans les discussions académiques et politiques, la mobilité des jeunes est souvent traitée avec ambivalence. Une ambivalence centrale concerne la mobilité des enfants, et reflète une importante institution socioculturelle, mais aussi un champ d’intervention orienté vers la protection de l’enfance et la lutte contre le trafic d’êtres humains. A cet égard, les débats mettent en évidence la tension entre l’âge biologique et les constructions sociales de l’enfance, et invitent à une analyse critique et empiriquement fondée des significations et des rôles de la famille, de la communauté et des soins. Comment les jeunes et les autres acteurs des contextes ouest-africains articulent-ils et contestent-ils les idées sur la migration des enfants et des jeunes ? Quelles sont les lignes de fracture entre les discours externes et localisés sur les droits et la protection des jeunes en mouvement, et à cet égard, quelles formes de mouvement sont les plus pertinentes dans des contextes empiriques spécifiques ?
DIRECTIVES DE SOUMISSION
Cet atelier se tiendra en présentiel ou virtuellement, et la participation repose sur la soumission d’un court résumé (200 mots) et d’une biographie (max 200 mots). Ces documents devront être envoyés à cohostingworkshop@codesria.org.
Dans votre courriel de candidature, veuillez indiquer si vous participerez virtuellement ou en personne, et si vous avez besoin d’aide financière pour couvrir vos frais de déplacement et d’hébergement.
Pour un engagement substantiel de tous les participants pendant l’atelier, tous devront soumettre un article complet avant l’atelier (voir les délais ci-dessous),.
Dates importantes
Date limite de soumission des résumés : 31 octobre 2022.
Les informations sur la sélection des contributions seront partagées avec tous les candidats au plus tard le 15 novembre 2022.
Les auteurs d’articles acceptés devront s’inscrire à l’atelier avant le 20 novembre 2022.
Les articles complets devront être soumis au plus tard le 25 novembre 2022.
Résumés papier
Longueur : 200 mots
Langue : anglais ou français
Police : Times New Roman 12
Aucune référence, tableau ou graphique dans le résumé.
Concernant les abréviations, veuillez écrire le nom complet à la première mention, avec l’abréviation entre parenthèses.
Le Comité Scientifique se réjouit, par avance, de recevoir vos contributions et de vous rencontrer en personne, cette année à Dakar.
Comité scientifique : Jesper Bjarnesen, Papa Sow, Khady Diop, Almamy Sylla.
Format de l’atelier
Jour 1 Session d’ouverture par les organisateurs (NAI et CODESRIA)
Café
Discours d’ouverture par un décideur/expert politique
Déjeuner
Session de communication 1 (4 communications)
Café
Session 2 (4 articles)
Table ronde
Dîner de travail
Jour 2 Réflexions par les organisateurs (NAI et CODESRIA)
Session 3 (4 communications)
Café
Session plénière sur les principaux points à retenir et les idées de projet(s) de publication, modérée par les organisateurs.
Clôture de l’atelier
Déjeuner